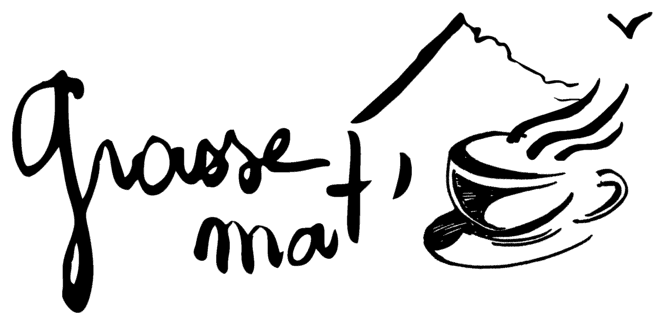3 mars 1861, L'abolition du servage de 1861 est une réforme agraire de grande importance dans l'Empire russe au début du règne de Alexandre II, qui a pour but principal l'abolition du servage et la vente de terres agricoles aux serfs ainsi affranchis. Celle-ci entre en vigueur le 3 mars 1861, (ou le 19 février selon le calendrier julien alors en usage). Selon le juriste et philosophe russe Boris Tchitcherine il s'agit de l'«œuvre la plus grandiose de l'histoire russe ».
La réforme, longtemps attendue, a pour conséquence de libérer 23 millions de paysans du statut de serf. La réforme a cependant eu un impact limité dans certains domaines : ainsi les serfs liés à des terres étatiques n'ont été libérés de leur statut qu'en 1866. Cette réforme est portée par Nikolaï Milioutine, Alexei Strolman et Yakov Rostovtsev, notamment via l'élaboration d'un manifeste en faveur de cette réforme.
Une conséquence secondaire est l'ouverture de nouvelles prisons d'État : en retirant aux propriétaires terriens la prérogative d'incarcérer leurs valets de charrue, la Couronne de Russie doit prendre en charge l'application des peines prévues par la loi pour cette population.
Monté sur le trône en mars 1855, Alexandre II mène une politique réformiste afin d'apaiser l'empire dans le contexte difficile de la défaite lors de la guerre de Crimée. La réforme agraire qu'il souhaite est tout entière marquée par la volonté impériale et Alexandre II y est indissolublement lié. L'abolition définitive du servage dans le pays lui vaudra le qualificatif de « tsar libérateur ».
Sur une population de 60 millions d'habitants, 50 millions étaient des serfs, la moitié servant environ 100 000 familles nobles, l'autre moitié les domaines de l'État.